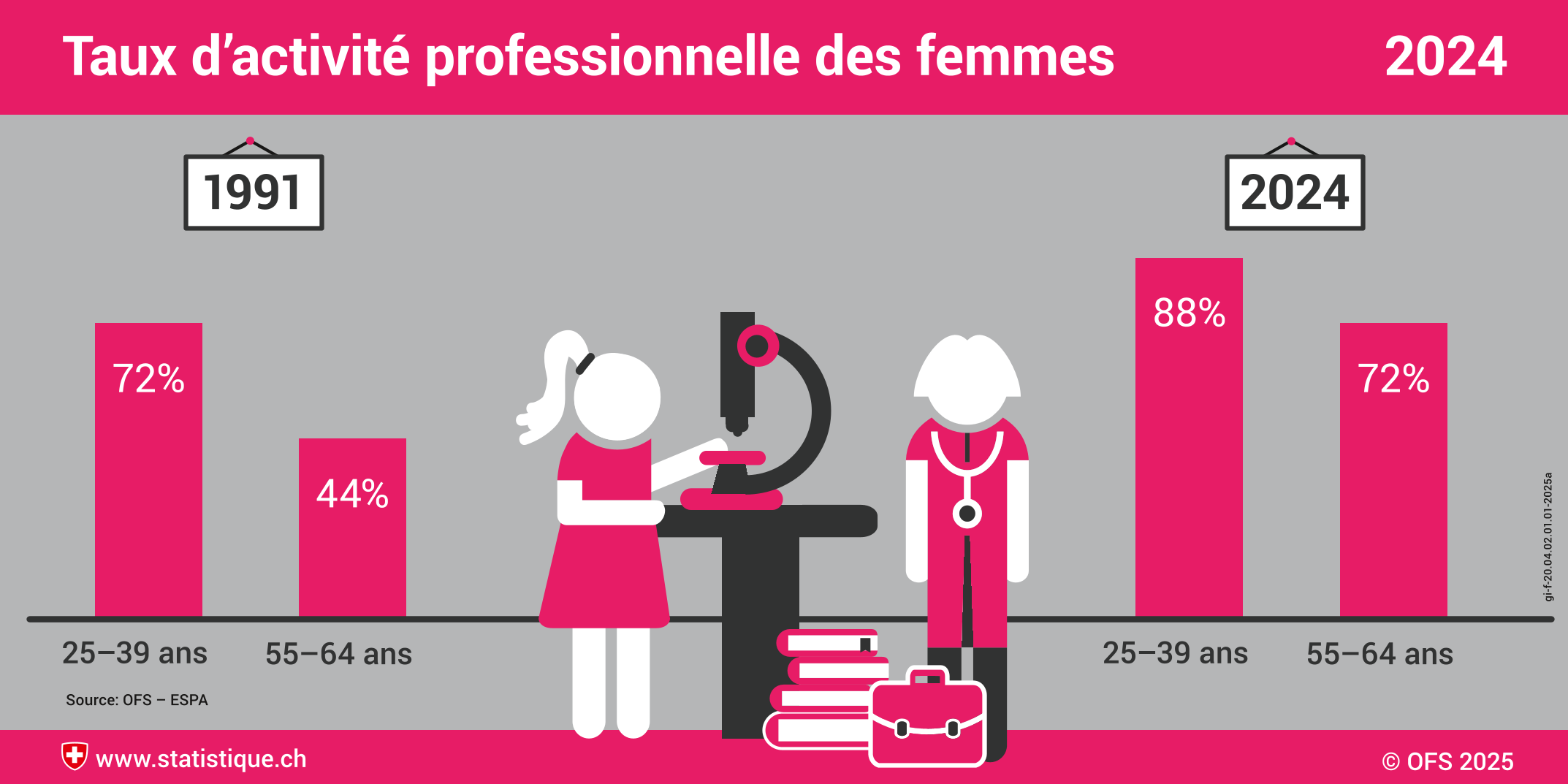En 2024, la population résidante permanente de la Suisse a franchi un nouveau cap pour atteindre 9 048 900 d'habitants au 31 décembre. Une baisse de la fécondité est observée pour la troisième année consécutive. Le nombre moyen d'enfants par femme tombe au niveau le plus bas jamais enregistré. Le nombre de décès est resté stable et l'espérance de vie continue d'augmenter. Les immigrations ont fortement diminué après une année record en 2023. Les émigrations ont, quant à elles, évolué à la hausse. Ce sont là quelques-uns des résultats annuels provisoires 2024 de la statistique de la population et des ménages et de celle du mouvement naturel de la population de l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La population résidante permanente de la Suisse s'élevait à 9 048 900 personnes au 31 décembre 2024, contre 8 962 300 fin 2023 (+86 600 personnes, soit +1,0%). Cet accroissement démographique est inférieur à celui enregistré en 2023 (+1,7%), année qui avait été marquée par un solde migratoire très élevé. Ceci était principalement dû à la prise en compte des personnes détentrices du statut de protection S en provenance d'Ukraine dans la population résidante permanente une année après leur arrivée.
La population a augmenté dans tous les cantons. La croissance la plus forte est enregistrée à Schaffhouse (+1,8%), à Fribourg et en Valais (respectivement +1,5%). La plus faible évolution est constatée dans les cantons du Tessin et d'Appenzell Rhodes-Extérieures (respectivement +0,3%) ainsi que dans le canton du Jura (+0,4%).
Recul des naissances et stabilisation des décès
La Suisse a provisoirement enregistré 78 000 naissances vivantes en 2024, soit 2000 ou 2,5% de moins qu'en 2023. Le nombre de naissances diminue ainsi pour la troisième année consécutive. La baisse s'atténue toutefois en comparaison à l'année précédente : entre 2022 et 2023, on avait observé une diminution de 2300 naissances (-2,8%). En 2024, le nombre moyen d'enfants par femme s'est établi provisoirement à 1,28, contre 1,33 en 2023. Ceci constitue la valeur la plus basse jamais enregistrée en Suisse.
Rapporté à la population, le nombre de naissances en 2024 se situe également en dessous de celui des dernières années (8,7 naissances pour 1000 habitants en 2024, contre 9,0 en 2023 et 9,4 en 2022). On dénombre moins de naissances qu'en 2023 dans presque tous les cantons. Seuls le Valais et Bâle-Campagne font exception à la règle avec, selon les résultats provisoires, une faible augmentation (respectivement +0,9% et +0,1%).
En 2024, la Suisse comptait 71 800 décès, un chiffre provisoire équivalent à celui enregistré en 2023. Le nombre de décès progresse dans onze cantons. L'augmentation la plus marquée s'observe à Appenzell Rhodes-Extérieures (+6,4%), à Zoug (+5,3%) et à Schwyz (+5,2%). Au contraire, les cantons de Nidwald (-13,5%), d'Obwald (-7,9%) et de Schaffhouse (-4,8%) affichent une diminution particulièrement prononcée.
Le nombre de naissances étant bas et celui des décès se maintenant à un niveau élevé, l'accroissement naturel - soit la différence entre les naissances et les décès - s'établit provisoirement à 6200 personnes en 2024. Il s'agit du niveau le plus bas observé depuis 1918, année durant laquelle l'accroissement naturel était négatif en raison de la grippe espagnole et de la Première Guerre mondiale. Onze cantons enregistrent plus de décès que de naissances en 2024 à savoir Berne, le Tessin, les deux Bâle, les Grisons, Soleure, le Jura, Neuchâtel, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures et Glaris.
L'espérance de vie à nouveau en hausse
Le nombre élevé de décès enregistrés en Suisse est principalement dû au vieillissement de la population - 88% de ces décès concernent des personnes de 65 ans ou plus. L'espérance de vie à la naissance a continué d'évoluer à la hausse en 2024 pour atteindre 86,0 ans chez les femmes (2023: 85,8 ans) et 82,5 ans chez les hommes (2023: 82,2 ans). On observe une évolution similaire pour l'espérance de vie à 65 ans, avec +0,2 an tant pour les femmes que pour les hommes, pour s'élever respectivement à 23,0 et 20,5 ans (chiffres provisoires).
L'immigration en baisse mais toujours élevée
L'immigration a nettement baissé en 2024, après avoir atteint un niveau historiquement élevé en 2023. À la fin de l'année, on compte 212 700 immigrations, cumulant celles des Suisses (22 600) et des personnes de nationalité étrangère (190 100), soit une diminution de 50 300 (-19,1%) par rapport à l'année précédente. Le nombre d'immigrations était particulièrement important en 2023 du fait de l'immigration économique en provenance de l'UE et de la comptabilisation, dans la population résidante permanente, des personnes en provenance d'Ukraine détentrices du statut de protection S. En 2024, 9600 personnes à protéger de nationalité ukrainienne ont rejoint la population résidante permanente une année après leur arrivée, ce qui équivaut à 4,5% des immigrations totales. En 2023, cela concernait 50 600 personnes, soit 19,2% des immigrations.
À l'inverse, les émigrations ont augmenté légèrement (+1600, soit +1,3%) par rapport à l'année précédente. On en enregistre provisoirement 125 600, dont 30 100 de Suisses et 95 500 d'étrangers. Par conséquent, le solde migratoire (différence entre les immigrations et les émigrations) s'amenuise, passant de 139 100 en 2023 à 87 100 en 2024 (-37,4%, chiffres provisoires).
Entre 2023 et 2024, les immigrations des Suisses ont évolué à la hausse (+2,6%), alors que celles des personnes de nationalité étrangère ont fortement diminué (-21,1%). À l'inverse, les ressortissants suisses ont moins émigré qu'en 2023 (-1,8%) tandis que les émigrations de personnes de nationalité étrangère ont été plus fréquentes (+2,3%). Le solde migratoire s'établit provisoirement à 94 600 pour la population de nationalité étrangère et à -7500 pour celle de nationalité suisse.
Au 31 décembre 2024, le nombre de ressortissants étrangers séjournant de manière permanente en Suisse s'est ainsi élevé provisoirement à 2 478 700 personnes, soit 27,4% de la population résidante permanente. La population étrangère évolue plus rapidement que celle des Suisses (+2,5% contre +0,4%).
En savoir plus